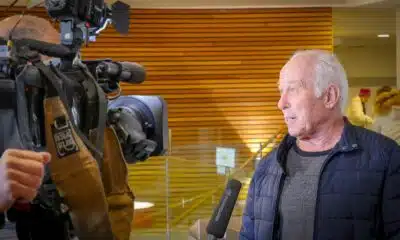Europe
Le désespoir des fermiers ukrainiens otages du blocus des céréales

Nadia Ivanova aurait dû moissonner dans les jours à venir, mais pour l’instant, cette exploitante agricole du sud de l’Ukraine exportant dans le monde entier n’a récolté que des obus.
« On a planté avec beaucoup de retard parce qu’il a fallu tout déminer avant », explique l’agricultrice de 42 ans au beau milieu de ses immenses champs fertiles.
Situés non loin de la ville de Mikolaïv, ils ont été pilonnés en mars quand les Russes tentaient d’avancer vers le nord, faisant pour seules victimes deux paons qui d’ordinaire régnaient sur la basse-cour.
On aperçoit encore un cratère, quelques outils sans valeur ont été maraudés, mais les troupes ennemies n’ont fait que passer et le front a depuis reculé à une vingtaine de kilomètres.
Pourtant le mal est fait.
« On a remplacé la moutarde, une plante précoce, par des tournesols ou du millet, plus tardifs », détaille dans sa robe zébrée cette femme en charge de 4.000 hectares, qui emploie 76 personnes.
Alors que la baisse production de céréales ukrainiennes fait craindre des crises alimentaires dans le monde, les obstacles s’accumulent pour Mme Ivanova.
Installée en 2003 avec son frère et ses parents sur un ancien « kolkhoze » qui livrait l’Union soviétique en tomates et concombres, elle ne peut plus anticiper.
L’orge est à maturité, le lin offre aux abeilles ses belles fleurs bleues. Une chienne a mis bas. Les premières cerises bien sucrées, fiertés de la contrée, sont là.
En temps de paix, sa production – plus de 12.000 tonnes par an – aurait été destinée au marché intérieur et à l’export vers l’Europe, l’Afrique et la Chine.
Faute de mieux
Aujourd’hui, ses immenses hangars abritent encore 2.000 tonnes des grains de la saison dernière, qui ne trouvent pas preneurs.
Faute de mieux et pour faire de la place, ils sont conditionnés dans de grands sacs synthétiques blancs en toile de jute.
Les voies ferrées ont été partiellement détruites par l’armée russe, tout bateau appareillant promet d’être coulé et le port de Mikolaïv a été ciblé par les missiles et les alternatives n’arrivent pas assez vite.
Résultat: le prix à la tonne a fondu. De 330 euros avant la guerre, il plafonne à 100 euros maintenant.
Au sein de la ferme, le nettoyeur à grains a été impacté. Impossible de le remettre en marche: tant que les hostilités feront rage en zone rouge, banques et assurances ne suivront pas.
De toute façon, aucun réparateur ne veut aujourd’hui venir dépanner sous la menace des bombes, qui peuvent encore tomber à tout moment.
Et les machines agricoles restent criblées d’éclats.
Les mains fourrées dans les entrailles d’une moissonneuse-batteuse jamais utilisée et déjà hors d’usage, Serguiï Tchernychov, 47 ans, peau tannée, se désole.
« Il va me falloir encore une semaine pour voir si je peux la remettre en service », affirme-t-il. Rutilante malgré ses blessures apparentes, elle avait coûté 300.000 euros.
« Il faut y aller »
Et puis tous les prix flambent: engrais, pesticides… Le fuel a triplé, quand on met la main dessus. L’eau reste impropre à la consommation.
D’autant que cette année encore, la sécheresse va faire des ravages. Les épis de blé sont rachitiques.
Mais Nadia Ivanova, qui de temps à autre pointe une cigogne ou un héron en souriant, poursuit l’activité coûte que coûte. Ne pas récolter soumettrait ses terres au risque d’incendie, démultiplié par les tirs.
Assis sur un tracteur rouge, l’un des rares à rouler, Oleksandr Khomenko, 38 ans, désherbe donc une parcelle à ensemencer dans une belle odeur de coupe fraîche.
« Peur ou pas peur, il faut y aller: j’ai une famille à nourrir », lance-t-il en marcel blanc, sous le bruit des missiles qui sifflent au loin.
La plupart des employés répondent à l’appel et continuent de percevoir leur solde. « Je ne sais pas combien de temps je vais tenir », souffle la patronne. « Mais chez moi au moins, il y aura toujours à manger ».
Europe
Espagne: Une Française retrouvée morte dans son camping-car, la piste criminelle privilégiée

Une femme de 63 ans a été retrouvée morte poignardée dans son camping-car à Alcossebre, sur la côte est de l’Espagne, jeudi 18 juillet. Les enquêteurs n’excluent aucune piste, rapporte le site L’Espanol.
Ce jeudi, une femme a été retrouvée morte dans son camping-car, stationné sur une place d’Alcossebre, sur la côte est de l’Espagne. Le corps de la victime présentait des traces de coups de couteau, selon le média local L’Espanol. Elle avait également un couteau planté dans le visage. La Garde civile a indiqué à nos confrères espagnols que la femme, âgée de 63 ans, était de nationalité française et semblait voyager seule comme touriste.
Une enquête pour meurtre a été ouverte et une autopsie doit être menée prochainement. Pour l’heure, les enquêteurs tentent d’identifier la victime et de recueillir des preuves visant à clarifier la cause du décès. Aucune piste n’est écartée pour le moment. Les premiers éléments de l’enquête ont permis de retracer le parcours de la sexagénaire.
Avant d’arriver à Alcossebre, la victime avait séjourné à Tarragone, à environ 150 km au nord. Elle avait également été inscrite seule. Les forces de l’ordre ont interrogé les voyageurs qui occupaient les caravanes garées à proximité de celle de la femme. Selon les premiers témoignages, elle était garée dans la zone depuis deux jours. Certains ont par ailleurs indiqué avoir vu un homme en compagnie de cette dernière, les heures précédant sa mort. L’individu est actuellement recherché.
Europe
Ukraine : Zelensky favorable à une participation russe à un sommet pour la paix

Pour la première fois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déclaré favorable à la participation de représentants russes à un prochain sommet pour la paix. Il reste confiant quant au soutien des États-Unis, même en cas de retour au pouvoir de Donald Trump.
Lundi 15 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a surpris en se déclarant ouvert à la participation de la Russie à un futur sommet pour la paix, organisé par Kiev. Lors d’une conférence de presse, il a affirmé que des représentants russes devraient participer à ce deuxième sommet, espérant qu’un plan puisse être prêt en novembre. Zelensky n’a pas évoqué l’arrêt des hostilités, mais l’établissement d’un plan sur trois sujets : la sécurité énergétique de l’Ukraine, la libre navigation en mer Noire et les échanges de prisonniers.
C’est la première fois que Zelensky envisage des discussions avec la Russie sans exiger un retrait préalable des forces russes du territoire ukrainien. Par le passé, il avait refusé toute négociation tant que Vladimir Poutine resterait au pouvoir, allant jusqu’à signer un décret rendant illégales de telles discussions.
Le premier sommet pour la paix en Ukraine, organisé en Suisse en juin, avait rassemblé une centaine de pays, sans la Russie et sans la Chine, alliée de Moscou. En 2022, l’Ukraine avait proposé un plan de paix en dix points, soutenu par l’Occident et impliquant le retrait des forces russes, une proposition rejetée par Moscou.
Volodymyr Zelensky a également affirmé ne pas craindre une éventuelle réélection de Donald Trump à la présidence américaine, malgré les incertitudes que cela pourrait entraîner sur le soutien de Washington à Kiev. « Je pense que si Donald Trump devient président, nous travaillerons ensemble. Je n’ai pas peur », a-t-il déclaré.
La perspective d’une victoire de Trump en novembre soulève des questions sur la continuité du soutien américain à l’Ukraine. Trump a laissé entendre qu’il mettrait fin rapidement au conflit s’il revenait à la Maison-Blanche, ce qui pourrait contraindre Kiev à négocier dans une position défavorable. Actuellement, près de 20% du territoire ukrainien est encore occupé par la Russie.
Cependant, Zelensky a souligné le soutien significatif du parti républicain aux États-Unis, affirmant que la majorité de ce parti soutient l’Ukraine. Il a récemment rencontré de nombreux élus républicains et noté que certains dirigeants républicains avaient des positions plus radicales que Trump lui-même.
En somme, le président ukrainien se montre ouvert à de nouvelles discussions pour la paix, tout en restant confiant quant au soutien international à son pays, indépendamment des changements politiques à venir aux États-Unis.
Europe
Brest refuse l’accès au voilier russe Shtandart en raison des sanctions européennes

La réplique d’une frégate russe du XVIIIᵉ siècle pourrait se voir refuser l’accès au port breton en raison des sanctions européennes.
Le navire russe Shtandart, une réplique d’une frégate du XVIIIᵉ siècle, pourrait se voir refuser l’accès au port de Brest lors des fêtes maritimes prévues du 12 au 17 juillet. Bien que l’événement attire chaque année des milliers de spectateurs, l’application des sanctions européennes contre la Russie, étendues depuis le 24 juin aux « navires répliques historiques », menace la participation de ce trois-mâts de 34 mètres de long.
Le Shtandart, parti de La Rochelle jeudi dernier, doit accoster à Brest malgré un arrêté de la préfecture interdisant son entrée. Le capitaine du navire, Vladimir Martus, se dit déterminé à tenter d’accoster, malgré les interdictions. « Nous allons entrer à Brest avec le voilier français Belem et d’autres bateaux (…) Je ne sais pas si la police va m’arrêter ou pas, mais je vais essayer », a-t-il déclaré.
Le navire, arborant désormais le pavillon des Îles Cook après avoir abandonné celui de la Russie à la demande des autorités françaises, suscite la polémique depuis des mois. Le capitaine Martus, qui se présente comme un dissident au régime russe, affirme œuvrer pour « l’amitié entre les peuples de toutes les nations » et a exprimé son soutien à la « lutte héroïque » des Ukrainiens contre l’agression russe, qualifiant Vladimir Poutine de « dictateur ».
Malgré ces déclarations, une source proche du dossier indique que le Shtandart ne devrait pas être autorisé à approcher de Brest, sauf pour une escale technique. Cette décision est soutenue par certains opposants au navire, qui contestent les intentions du capitaine. Bernard Grua, animateur du collectif « No Shtandart In Europe », accuse Martus de ne jamais critiquer la Russie sur les réseaux sociaux, affirmant que ses propos relèvent du « langage du FSB (ex-KGB) ».
Mardi après-midi, une trentaine de détracteurs du Shtandart se sont rassemblés devant la mairie de Brest, brandissant des drapeaux ukrainiens et des pancartes telles que « Russia go home » et « Shtandart: espion russe ». Ils ont également exprimé leur soutien au préfet du Finistère pour sa décision de tenir le navire à distance.
-
CultureEn Ligne 2 mois
Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle
-
ThauEn Ligne 2 mois
Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises
-
Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois
Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire
-
MarseillanEn Ligne 2 mois
Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres
-
ThauEn Ligne 1 mois
Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche