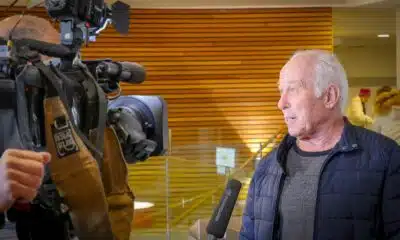Politique
Les Républicains élisent leur président

Les Républicains connaîtront dimanche soir le nom du nouveau président du parti, au terme d’un deuxième tour interne opposant Eric Ciotti, très ferme sur le régalien, et Bruno Retailleau, tenant d’une ligne conservatrice et libérale.
Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti est arrivé en tête du premier tour, le 4 décembre, avec 42,73% des voix, contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau (et 22,29% pour Aurélien Pradié, éliminé).
Les adhérents ont commencé à voter pour le 2e tour samedi à 18H00, et dimanche à 10H00 la participation atteignait 41% (contre 45% au premier tour à la même heure). Le scrutin électronique sera clos à 18H00 dimanche et la présidente par intérim Annie Genevard annoncera les résultats dans la foulée.
Il s’agit, pour les 91.110 adhérents, de choisir le successeur de Christian Jacob qui a démissionné en juin, après des élections qui ont acté l’affaiblissement du parti de droite, tombé à 4,8% à la présidentielle.
Dans la dernière ligne droite, les adhérents ont multiplié déplacements et interviews pour tenter d’emporter une élection beaucoup plus serrée que les précédentes, qui s’étaient jouées à un tour seulement.
Même si le député des Alpes-Maritimes part avec une longueur d’avance, il ne veut pas revivre le scénario de 2021 lorsque, arrivé en tête au premier tour de la primaire, il avait dû s’incliner au deuxième face à Valérie Pécresse, payant un « tout sauf Ciotti » chez les électeurs inquiets de sa ligne droitière.
Eric Ciotti, qui vante sa fidélité au RPR puis à LR, défend un cap « de droite assumée », « refusant le politiquement correct », avec un ton très ferme sur la sécurité et l’immigration. Bruno Retailleau, très critique de Nicolas Sarkozy, promet lui de « rendre le parti aux adhérents » consultés par référendum, avec une ligne « clairement de droite » quoique « sans outrance ».
Avec 73% de participation au premier tour, l’une des clés du second sera de mobiliser le gros quart d’abstentionnistes.
Et il faut surtout pour les candidats réussir à capter les 22% des voix réunies par Aurélien Pradié.
Celui-ci n’a pas donné de consigne de vote mais a exhorté vendredi les deux finalistes à prendre en compte la « droite populaire » qu’il a portée, dans un courrier interpellant Bruno Retailleau de façon voilée, quoique répétée.
« Légitimité »
Plusieurs de ses lieutenants, dont les députés Pierre-Henri Dumont et Raphaël Schellenberger, se sont rangés derrière Eric Ciotti.
Vendredi, Christian Jacob et le patron des députés LR Olivier Marleix ont apporté leur soutien à Eric Ciotti, qui se prévaut aussi de celui du maire de Troyes François Baroin.
Mercredi, 140 élus avaient expliqué dans une tribune qu’ils voteraient pour celui qui « fera gagner la droite ». Au premier rang des signataires, Laurent Wauquiez, présent jeudi soir lors d’une réunion publique à Paris.
Eric Ciotti promet de faire désigner rapidement le président de la région Auvergne-Rhône Alpes comme candidat à la présidentielle s’il est élu.
Un calendrier que son adversaire conteste. « Cette obsession de la présidentielle va nous tuer », répète Bruno Retailleau.
Parti en campagne comme le candidat des élus, ce dernier peut lui se prévaloir de l’appui du président du Sénat Gérard Larcher, de l’eurodéputé François-Xavier Bellamy, de François Fillon… mais aussi du président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui l’a appelé dimanche soir en privé.
Dans une tribune au Figaro lundi soir, quelque 120 parlementaires ont affiché leur choix en faveur de Bruno Retailleau, « candidat de la rupture, du renouvellement et du rassemblement ».
Le sénateur a par ailleurs saisi le parti jeudi soir pour lui demander d’étudier des mesures visant à « renforcer la sécurité et donc la légitimité » du second tour, après la publication d’une enquête de Libération sur « de puissants systèmes clientélistes » lors des adhésions dans les Alpes-Maritimes.
Politique
Politique : la gauche s’entend enfin et propose pour Matignon une haute fonctionnaire, Lucie Castets

Après plus de deux semaines de tensions et d’atermoiements, le Nouveau Front populaire a trouvé in extremis un accord pour Matignon : c’est Lucie Castets, une haute fonctionnaire inconnue du grand public mais engagée dans la défense des services publics, qui est proposée à Emmanuel Macron.
Une heure avant l’interview télévisée du chef de l’État, la gauche, en tête des législatives mais sans majorité absolue, a enfin trouvé un nom consensuel après 16 jours de négociations houleuses menaçant l’unité de l’alliance. Ce consensus tardif porte sur Lucie Castets, une haute fonctionnaire de 37 ans, issue de la société civile, que le Nouveau Front populaire (NFP) a immédiatement réclamé à Emmanuel Macron pour Matignon.
Les discussions, morcelées ces derniers jours, avaient repris mardi, avec le Parti socialiste fixant cette date comme limite aux interminables pourparlers. Le choix de Lucie Castets, une figure inattendue mais respectée pour son engagement envers les services publics, a été perçu comme une solution de compromis au sein des formations du NFP.
Cependant, le Président Macron a rejeté cette proposition, affirmant que le NFP n’avait « pas de majorité quelle qu’elle soit ». Il a insisté sur l’importance d’une majorité parlementaire stable pour adopter des réformes et faire avancer le pays, plutôt que de se concentrer sur un nom pour le poste de Premier ministre.
Cette position a provoqué l’indignation des leaders de gauche. Jean-Luc Mélenchon a accusé Macron de vouloir imposer un nouveau Front républicain, tandis qu’Olivier Faure, chef du PS, a dénoncé un déni qui conduirait à une « politique du pire ».
Contactée par le NFP, Lucie Castets a accepté la proposition « en toute humilité mais avec beaucoup de conviction », se disant « crédible et sérieuse » pour Matignon. Parmi ses priorités figurent l’abrogation de la réforme des retraites de Macron, une grande réforme fiscale, l’amélioration du pouvoir d’achat et la défense des services publics. Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, a souligné qu’elle serait « la Première ministre des avancées sociales et écologiques ».
Marine Tondelier, patronne des Écologistes, a confirmé la solidité et la crédibilité de Castets, validée par consensus des quatre formations politiques de l’alliance.
Inconnue du grand public, Lucie Castets est actuellement directrice des finances et des achats à la ville de Paris. Elle est également une figure de proue du collectif « Nos services publics », opposé aux politiques du gouvernement sortant concernant la fonction publique. Anne Hidalgo, maire de Paris, a loué sa gestion sérieuse d’un budget de 10 milliards d’euros.
Sans affiliation partisane actuelle, Castets a été membre du PS entre 2008 et 2011 et a été active dans le think tank « Point d’ancrage », revendiqué « social-réformiste ». Elle s’est engagée pour des causes telles que le mariage pour tous, l’égalité hommes-femmes et une meilleure redistribution des finances mondiales.
Castets fait également partie du bureau de l’Observatoire national de l’extrême droite, aux côtés de figures de la gauche comme Thomas Portes et Caroline Fiat. Son parcours, marqué par un engagement constant envers la justice fiscale et la lutte contre la fraude, en fait une candidate aux multiples compétences pour le poste de Premier ministre.
France
Paris 2024 : les ex-ministres et leurs conjoints conviés à la cérémonie d’ouverture malgré leur démission

Les anciens ministres du gouvernement Attal, accompagnés de leurs conjoints, ont été conviés à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue pour le vendredi 26 juillet. Malgré la démission récente du gouvernement, ces invitations visent à honorer leur contribution passée et à maintenir une présence institutionnelle lors de cet événement historique.
À seulement trois jours de la cérémonie d’ouverture, les invitations ont été officiellement envoyées aux anciens membres du gouvernement Attal, offrant à chacun deux places pour assister aux festivités depuis la tribune. Cette décision a été perçue comme nécessaire pour éviter une cérémonie sans représentation gouvernementale, un fait souligné avec une pointe d’humour par un secrétaire d’État également invité.
La plupart des anciens ministres ont accepté l’invitation et seront présents aux côtés du Président Emmanuel Macron, place du Trocadéro. Certains ont choisi de transmettre leurs places à leurs enfants, permettant ainsi à la jeune génération de participer à cette célébration sportive.
La cérémonie promet d’être un spectacle mémorable, avec des performances d’artistes ayant un lien fort avec Paris, bien que le programme détaillé reste en grande partie confidentiel. Le metteur en scène Thomas Joly a indiqué que même les artistes non francophones partagent une connexion spéciale avec la capitale française.
Conformément au protocole olympique, c’est le Président de la République qui aura l’honneur de déclarer officiellement l’ouverture des Jeux Olympiques, marquant ainsi le début de cette compétition internationale tant attendue.
France
Politique: Yaël Braun-Pivet réélue à la présidence de l’Assemblée nationale

Avec 220 voix obtenues lors du vote de ce jeudi 18 juillet, Yaël Braun-Pivet redevient la présidente de l’Assemblée nationale. Elle était talonnée par André Chassaigne, candidat du Nouveau Front populaire arrivé en tête au premier tour, et le candidat RN Sébastien Chenu.
Une nouvelle législature s’ouvre ce jeudi 18 juillet, avec l’élection du président de la nouvelle Assemblée nationale. Rassemblés pour la première fois depuis leur élection au second tour des législatives le 7 juillet, les 577 députés ont fait leur rentrée parlementaire au Palais Bourbon, où ils ont voté, en trois tours, pour élire le nouveau quatrième personnage de l’État.
C’est finalement Yaël Braun-Pivet qui l’a emporté, avec 220 voix, la majorité relative étant suffisante pour remporter le troisième tour. Candidate à sa propre réélection, elle faisait face à André Chassaigne du Nouveau Front populaire, arrivé second avec 207 voix, et Sébastien Chenu, du Rassemblement national, arrivé troisième avec 141 voix. Le scrutin s’est joué serré, après un premier tour remporté par André Chassaigne (NFP) à 200 voix, talonné par Sébastien Chenu (RN) à 142 voix et Yaël Braun-Pivet (ERP), arrivée troisième avec 124 voix. Philippe Juvin (Droite républicaine) et Naïma Moutchou (Horizons), ont eux quitté la course lors de ce premier round. La présidente sortante a créé la surprise au second, en devançant son adversaire du NFP avec 210 voix. Charles de Courson, candidat Liot courtisé car pouvant faire pencher la balance, s’est lui désisté au second tour après s’être maintenu au premier malgré ses 18 voix. Ce dernier a néanmoins exprimé son opposition au retour de Yaël Braun-Pivet au perchoir.
Un scrutin aux forts enjeux, sur lequel planait l’ombre des alliances, notamment avec le Rassemblement national, pouvant tout faire basculer. Cette XVIIe législature s’est ouverte à 15 heures, présidée par le député RN José Gonzalez, doyen de l’hémicycle. « Personne ne souhaite revivre les débordements malheureux qu’on a pu connaître dans la précédente mandature », a-t-il déclaré dans son discours, applaudi par une partie seulement de l’Assemblée. Même ambiance lors du vote, lorsque plusieurs élus, dont les Insoumis Clémence Guetté, Louis Boyard et David Guiraud, ont refusé la poignée de main tendue par le nouveau benjamin de l’Assemblée, le RN Flavien Termet, 22 ans. Cette tension palpable s’est maintenue jusqu’au troisième tour.
Du côté du parti présidentiel, rebaptisé Ensemble pour la République (EPR), certains députés ont confié à Libération craindre « un baiser de la mort » du RN, avec le désistement de Sébastien Chenu au profit de Yaël Braun-Pivet. Une hypothèse déjà esquissée par Le Figaro, qui pointait une entente de la présidente sortante avec l’extrême droite, ce que l’intéressée a fermement nié. « On ne demande pas les voix du RN, on ne leur donne pas nos voix. Si le RN veut faire ça pour nous embêter, c’est leur problème, on n’est pas responsables de leurs votes », a confié un député à Libération, rappelant la ligne établie lundi par Gabriel Attal lors d’une réunion avec le groupe EPR : ni-LFI, ni-RN.
Pour cette première séance, en l’absence de président, les cartes étaient plus que jamais rebattues avec le placement par ordre alphabétique. Ainsi, note Libération, Gabriel Attal s’est retrouvé à côté de l’ex-Insoumise Clémentine Autain, la cadre de LFI Sophia Chikirou à droite du candidat RN au perchoir Sébastien Chenu, et Jérôme Guedj, dissident socialiste opposé à toute alliance avec LFI, a dû s’asseoir à côté de Clémence Guetté, Insoumise de premier plan.
Le Nouveau Front populaire, groupe majoritaire en sièges, s’est par ailleurs inscrit du côté de l’opposition plutôt que de la majorité. Un positionnement obligatoire mais réversible, nécessaire pour la publication au Journal Officiel du lendemain, qui annonce la teneur de la nouvelle Assemblée.
-
CultureEn Ligne 2 mois
Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle
-
ThauEn Ligne 2 mois
Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises
-
Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois
Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire
-
MarseillanEn Ligne 2 mois
Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres
-
ThauEn Ligne 1 mois
Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus
-
SèteEn Ligne 2 mois
Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche