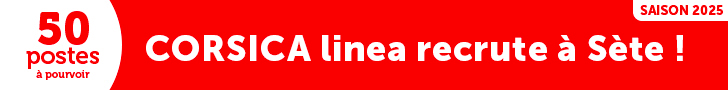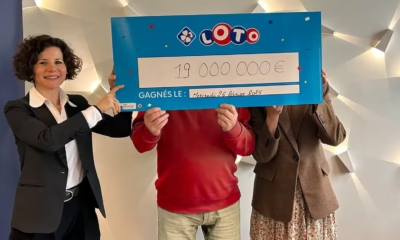Derrière les vitrines du célèbre musée parisien, des artisans passionnés perpétuent un savoir-faire ancestral, mêlant science et précision artistique.
Dans l’atelier discret du Muséum national d’histoire naturelle, des mains expertes s’affairent à redonner une seconde vie à des spécimens animaliers. Sous les doigts agiles des taxidermistes, une mérione – petit rongeur des déserts – retrouve peu à peu sa posture naturelle. Armatures métalliques, coton et résine remplacent muscles et squelette, tandis que des billes de verre restituent le regard de l’animal. Chaque détail compte, des griffes aux oreilles, pour une reconstitution fidèle à la réalité.
Non loin de là, une antilope subit une restauration minutieuse. Les années, les mites et les variations climatiques malmènent ces pièces fragiles, exigeant des interventions régulières. L’atelier regorge d’outils traditionnels et d’animaux en attente de soins, témoins silencieux d’une biodiversité à préserver.
Le Muséum conserve des millions de spécimens, certains datant d’avant la Révolution française. Aujourd’hui, les nouveaux arrivants proviennent majoritairement de zoos ou de centres de soins, loin des grandes expéditions naturalistes du passé. Chaque animal est méticuleusement documenté : mesures, prélèvements d’ADN, échantillons tissulaires. Ces collections, véritables bibliothèques du vivant, servent toujours la recherche, permettant d’étudier l’évolution des espèces ou les effets du changement climatique.
La taxidermie moderne s’éloigne des dioramas figés du XIXe siècle pour privilégier des poses dynamiques, plus parlantes pour le public. Les techniques évoluent aussi : sculptures en polyuréthane pour les grands mammifères, recours à l’impression 3D. Mais certaines espèces, comme les céphalopodes ou les cétacés, résistent encore à cet art délicat.
En France, seuls quelques spécialistes exercent dans les musées, alliant savoir-faire manuel et connaissances anatomiques poussées. Un métier exigeant, où chaque réalisation – comme celle, complexe, d’un orang-outan – relève autant de la science que de l’émotion.